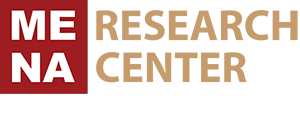Étant donné les récents messages de l’administration Trump concernant l’OTAN, l’UE, l’Ukraine et la Russie, nous avons décidé d’en discuter avec le , docteur (PhD) en sciences militaires et docteur en sciences techniques, professeur. Ancien Chef adjoint de l’état-major général des forces armées d’Ukraine (2006-2010). L’entretien a été mené par Denys Kolesnyk, consultant et analyste français.
Les dernières déclarations émanant de Washington ont laissé les Européens et les Ukrainiens perplexes. Trump a appelé à l’ouverture immédiate de négociations, mais les mesures concrètes et les stratégies de l’administration pour parvenir à la paix restent floues. Comment caractériseriez-vous la dynamique actuelle ? Selon vous, que peut-on attendre du changement d’approche des États-Unis vis-à-vis de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et comment cela pourrait-il affecter l’obtention d’un cessez-le-feu ou d’une paix ?
Les Américains tentent de changer la situation en passant à un nouveau niveau de vision stratégique et en révisant la répartition de l’influence dans le monde. Ce processus, le plus probablement, n’impliquerait que trois acteurs majeurs : les États-Unis, la Russie et la Chine. Dans le même temps, la principale confrontation se joue entre Washington et Pékin, et l’un des principaux objectifs de la politique américaine est de briser l’alliance entre la Fédération de Russie et la Chine. Sur la base de cette approche stratégique, Washington est prêt à renoncer à certaines questions de sécurité en Europe, y compris les intérêts de l’Ukraine, afin d’atteindre des objectifs géopolitiques globaux.

Alors que les priorités stratégiques de la Russie se concentrent sur plusieurs aspects essentiels. Tout d’abord, elle cherche à saper la stabilité de l’Occident et de l’OTAN. Le deuxième objectif est de diviser les États-Unis et les pays européens, ce qui pourrait affaiblir l’unité de l’Alliance. La troisième orientation importante est de reprendre le contrôle de l’Europe de l’Est, ce qui inclut le renforcement de son influence sur les pays post-soviétiques. À cette fin, la Russie organise activement des événements diplomatiques, notamment les récents entretiens téléphoniques, les consultations en Arabie saoudite etc.
Et les États-Unis s’attachent avant tout à modifier l’équilibre mondial des pouvoirs en renouant des relations avec la Russie, ce qui est une priorité pour eux. La cessation des hostilités entre Moscou et Kiev et l’instauration de la paix en Ukraine ne sont considérées que comme un aspect secondaire. Des discussions ont déjà commencé à un niveau préliminaire sur les futurs changements mondiaux qui devraient constituer la base d’un nouveau format de relations entre la Maison Blanche et le Kremlin. Un algorithme possible pour la mise en œuvre de ce plan a également été identifié. La première étape est la cessation des hostilités, qui pourrait avoir lieu entre le 20 avril et le 9 mai. La deuxième étape est l’organisation d’élections en Ukraine, en principe à l’automne, qui devraient constituer la base de l’étape suivante. D’ici la fin de l’année, les accords de cessez-le-feu pertinents devraient être signés, mais il convient de noter que l’interprétation de ce processus diffère : pour l’Ukraine, il s’agit d’un cessez-le-feu, tandis que la Russie et peut-être les États-Unis considèrent cette question dans un contexte plus large comme un accord de paix selon leurs propres termes.
La Russie poursuit ses opérations offensives, tandis que l’Ukraine est contrainte de se retirer de certaines positions. Cette tendance dure depuis au moins six mois. Comment voyez-vous l’évolution des hostilités sur le théâtre de Donetsk ? Quels sont les objectifs militaires actuellement poursuivis par les dirigeants politiques russes ? Que fait l’Ukraine et que peut-elle faire pour stopper l’avancée des troupes russes ? Comment l’opération dans la région de Koursk a-t-elle affecté les capacités des forces armées russes en Ukraine et comment le territoire contrôlé par l’Ukraine dans la région de Koursk peut-il être utilisé dans les négociations futures ?
La Fédération de Russie continue d’utiliser la situation sur les lignes de front en sa faveur, tout en procédant à des bombardements massifs sur l’ensemble du territoire ukrainien afin d’accroître la pression et d’atteindre ses objectifs stratégiques de guerre. Depuis près de 18 mois, elle mène une opération offensive de grande envergure, subissant des pertes importantes, ce qui l’a privée de la capacité de mener simultanément des hostilités actives dans toutes les zones. Les priorités actuelles sont les batailles dans la région de Koursk, où les troupes russes tentent de déloger les forces armées ukrainiennes, et la poursuite de l’avancée sur le front de l’Est, notamment dans les régions de Donetsk, Louhansk, et au Sud — Zaporizhzhia et Kherson. En outre, la Russie a systématiquement pris pour cible des installations militaires et économiques à l’intérieur du territoire ukrainien, cherchant à saper sa stabilité économique et ses capacités de défense.
Quant à l’utilisation du territoire de Koursk par les forces ukrainiennes, ce facteur peut être considéré comme un levier supplémentaire dans les négociations. Il est déjà clair qu’après les déclarations de Trump, la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a été effectivement retirée de l’ordre du jour, il est donc stratégiquement important d’avoir autant de « cartes » de ce type que possible qui peuvent être utilisées dans les négociations diplomatiques pour échanger contre les territoires temporairement occupés par la Russie. Cela pourrait devenir l’un des principaux arguments dans les négociations sur la poursuite du règlement du conflit.
L’élément décisif qui pourrait changer fondamentalement le cours de la guerre reste un approvisionnement important et opportun en armes de la part des alliés. L’Europe devrait intensifier ses efforts à cet égard et les États-Unis devraient donner à l’Ukraine la possibilité d’acheter les armes nécessaires en quantités suffisantes. Dans le même temps, l’Ukraine devrait procéder à une mobilisation à grande échelle, notamment en abaissant l’âge de la conscription à 18 ans, ce qui permettra non seulement de renforcer les brigades existantes, mais aussi de créer des unités de réserve. La décision de passer à un système basé sur les corps d’armée, qui a déjà été approuvée au niveau du commandant en chef suprême, est également importante. Toutefois, sa mise en œuvre est actuellement entravée par les risques politiques liés à la mobilisation. Si l’abaissement d’age de la mobilisation est encore reportée, non seulement il sera impossible d’atteindre les objectifs stratégiques, mais la capacité de défense de l’Ukraine s’en trouvera considérablement affaiblie à long terme.
Hier à Paris, sous les auspices d’Emmanuel Macron, une conversation a eu lieu avec les principaux pays de l’UE sur l’Ukraine. Londres a fait des déclarations sur le possible déploiement de troupes britanniques en Ukraine après la signature du cessez-le-feu afin d’assurer la sécurité. Selon vous, quelles sont les véritables garanties de sécurité pour l’Ukraine de la part des pays de l’UE, étant donné que l’adhésion à l’OTAN reste un objectif inaccessible pour Kiev ? Quels sont les mécanismes (politiques et militaires) qui peuvent être utilisés ?
Étant donné que, pendant les trois années de guerre à grande échelle, l’Ukraine n’a pas exploité les opportunités qui se sont ouvertes lors des offensives actives, comme les opérations de Kharkiv et de Kherson, on peut dire qu’il y avait un moment plus favorable pour mener un processus de négociation à des conditions plus avantageuses. Cependant, plusieurs facteurs ont empêché cela de se produire.
Tout d’abord, l’administration Biden a adopté une stratégie de « contrôle de la situation », ce qui s’est traduit notamment par des retards dans les livraisons d’armes – à certains moments, la pause a duré jusqu’à six mois. Les pays européens, quant à eux, ont été trop lents à reconstruire leurs propres industries de défense, ce qui a entraîné des fournitures d’équipements et de munitions insuffisantes et tardives. De plus, l’Ukraine elle-même n’a pas rempli les principales tâches de mobilisation, ce qui a également limité ses capacités. En conséquence, des opportunités favorables pour influencer le cours de la guerre ont été perdues, et maintenant l’Ukraine et ses partenaires se retrouvent dans une réalité stratégique différente, compte tenu de la situation sur le front et du contexte international.
Dans ce contexte, la question du soutien sécuritaire futur à l’Ukraine se pose, car les États-Unis ont considérablement modifié leur approche. Ils ne sont plus prêts à fournir le niveau d’aide militaire requis – ni sous forme d’armes, ni d’équipements, ni de munitions, et le déploiement de troupes américaines en Ukraine est exclu. Dans cette situation, il ne reste que l’espoir en l’Europe, mais sa position demeure hétérogène, et aucune décision finale n’a été prise quant aux futurs formats de soutien. La question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a été pratiquement close, et l’option de lignes de contact fixes est en discussion, ce qui signifierait un contrôle de facto de la Russie sur les territoires occupés, bien que personne ne reconnaîtrait cela juridiquement.
Dans ces circonstances, l’Ukraine cherche des mécanismes alternatifs pour assurer sa sécurité grâce au soutien des pays occidentaux. Initialement, elle comptait sur les Américains, cherchant à conclure des accords similaires à ceux que les États-Unis ont avec Israël, la Corée du Sud et le Japon. Cependant, la probabilité que les États-Unis acceptent de telles conditions reste faible. À cet égard, la possibilité de déployer des contingents militaires étrangers sur la ligne de contact est envisagée. Les Ukrainiens estime le besoin s’élève de 100000 à 200000 soldats, tandis que les partenaires européens jugent que le chiffre entre 30000-40000 est plus réaliste. Il est tout à fait possible que des compromis soient trouvés, mais même si une telle décision est prise, il est peu probable que des troupes étrangères participent directement aux combats. Leur mission consisterait plutôt à dissuader l’escalade et à maintenir la stabilité sur la ligne de contact.
Dans le cadre de cette approche, l’administration américaine a élaboré un document contenant six questions destinées aux pays européens sur les formes d’aide qu’ils attendent de Washington – qu’elle soit politique, militaire ou économique. Cela devrait permettre de déterminer dans quelle mesure l’Europe est prête à prendre en charge les questions de sécurité, à la fois au sein de la région dans son ensemble et en Ukraine. À cet égard, le président français Emmanuel Macron a tenu une série de réunions à Paris pour discuter des formats possibles de soutien. Seuls quelques pays ont exprimé leur volonté d’envoyer des troupes en Ukraine, et le Royaume-Uni a même déclaré son soutien total à cette initiative. Parallèlement, l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne se sont montrées très sceptiques à ce sujet. Quoi qu’il en soit, les discussions se poursuivront, car ce débat est crucial pour l’élaboration d’une décision commune de l’Union européenne sur son rôle dans la sécurité de l’Ukraine et de l’UE.
Aujourd’hui, des négociations ont lieu à Riyad entre les représentants des États-Unis et de la Russie. L’isolement diplomatique de la Russie est de facto terminé. Comment évaluez-vous le fait que les États-Unis préfèrent dialoguer directement avec Moscou sans l’implication directe de l’Ukraine et de l’Union européenne ? Quelles sont vos attentes concernant cette réunion ?
La réunion de Riyad a montré que les États-Unis se sont éloignés de l’approche qu’ils avaient déclarée pendant trois ans de guerre, selon laquelle il était impossible de négocier sur l’Ukraine sans sa participation directe. Washington a violé ce principe unilatéralement, bien qu’il ait justifié sa décision en affirmant que le principal sujet de discussion concernait des questions mondiales et la restauration des relations avec la Russie dans les domaines militaire, politique et économique. Dans le même temps, les États-Unis ont esquissé leurs positions initiales sur l’Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a clairement exprimé sa position : toute décision issue de cette réunion ne sera pas reconnue par l’Ukraine, car les États-Unis ont rompu leur propre engagement.
Cette situation reflète un changement dans la stratégie américaine. Washington a, en réalité, abandonné la politique d’isolement de la Russie au profit d’une restauration des relations avec elle, dans le but d’affaiblir ses liens avec la Chine. Cependant, le prix de cette approche repose sur les intérêts de l’Ukraine et de l’Europe. Dans le même temps, la mise en œuvre complète de cette stratégie dans sa forme pure semble peu probable, car une victoire inconditionnelle de la Russie – avec ses objectifs de « dénazification », de « démilitarisation » et de reprise de contrôle sur l’Europe de l’Est – porterait un coup sérieux à la réputation des États-Unis et de Donald Trump en particulier.
L’un des résultats clés de cette réunion a été l’élaboration d’un algorithme pour le processus de négociation. Ses étapes prévues sont les suivantes : arrêt de la guerre – provisoirement en avril-mai ; organisation d’élections en Ukraine – présidentielle, législatives et locales. La Russie espère que ce processus conduira à un changement de gouvernement et au départ de Zelensky, ce qui constitue l’un des objectifs politiques fixés par le Kremlin. Les négociations devraient être conclues d’ici la fin de l’année, avec une nouvelle direction à la tête de l’Ukraine.
La position officielle des autorités ukrainiennes est qu’il est impossible d’organiser des élections pendant ou immédiatement après la guerre. Cependant, l’Ukraine subira des pressions, et compte tenu de l’opinion publique, cette idée pourrait recevoir un certain soutien. De nombreux Ukrainiens sont favorables à un cessez-le-feu et à des élections, à condition que les militaires puissent y participer.
La poursuite de la guerre, tant sur le plan militaire que diplomatique, n’est possible que si l’aide militaire des alliés – armes, équipements, munitions – est considérablement augmentée et si une mobilisation totale est mise en œuvre. Cette dernière option est une mesure impopulaire et difficile pour le leadership ukrainien. Si cela ne se produit pas, la situation sur le front ne s’améliorera pas, et l’Ukraine devra faire des choix difficiles.
Et enfin, que peut faire l’Ukraine maintenant pour éviter de perdre sa subjectivité ?
La réponse réside dans la résolution des problèmes sur deux fronts : externe et interne. Dans le domaine de la politique étrangère, l’Ukraine doit clairement identifier les forces mondiales qui la soutiennent réellement dans cette lutte. Il est essentiel de distinguer ceux qui se contentent de déclarer leur aide de ceux qui sont capables d’agir dans des conditions critiques. Ces derniers incluent certains pays européens et quelques acteurs internationaux. L’Ukraine doit progressivement mais avec assurance s’engager dans le processus de négociation, tout en adaptant sa diplomatie aux spécificités de la coopération avec différents centres d’influence. Cela implique une interaction distincte avec les États-Unis, un approfondissement du partenariat avec les pays européens, l’établissement d’un dialogue stratégique avec la Chine et le développement de contacts avec les pays du Sud global, la Turquie et tous les États susceptibles d’influencer le processus de négociation et d’apporter leur soutien à l’Ukraine.
Sur le plan de la politique intérieure, un effort significatif de mobilisation est nécessaire. Tout d’abord, il est impératif de donner un puissant élan à l’industrie de la défense en la basculant vers un mode de fonctionnement militaire à part entière, ce qui n’a pas encore été mis en place après trois ans de guerre. Une mobilisation générale à partir de 18 ans, conformément à la législation en vigueur, devrait également être instaurée, et la responsabilité des citoyens en matière de sécurité et de défense nationale doit être renforcée. Le cadre juridique actuel ne prévoit pas un niveau de responsabilité suffisant en raison de l’absence d’un véritable état de guerre officiel, qui permettrait la mise en œuvre de mesures plus strictes. L’Ukraine devrait appliquer les normes légales en vigueur en temps de guerre, y compris la possibilité d’imposer les sanctions les plus sévères pour les infractions pertinentes. Cela favoriserait la discipline et l’efficacité dans l’accomplissement des missions.
Une fois les hostilités terminées, le pays devra entreprendre des réformes de grande ampleur dans les domaines économique et social. Pour assurer leur succès, il est indispensable d’opérer des changements profonds dans le système judiciaire, qui constitue actuellement un frein au développement de l’État, et de créer les conditions nécessaires à la reconstruction du pays après les ravages de la guerre, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités militaires et sécuritaires. Une tâche essentielle consistera à établir de nouvelles bases pour le développement de l’État, favorisant la croissance économique et la stabilité.
L’atteinte de ces objectifs ne sera possible qu’au prix d’un travail difficile mais nécessaire, qui sera crucial pour l’avenir du pays. Ce processus devra être soutenu par des élections démocratiques, qui devraient avoir lieu cette année.