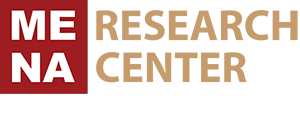En Allemagne, la loi garantit le droit à l’égalité de traitement pour tous, personne ne pouvant être discriminé en raison de son origine, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle. Toutefois, la réalité dans les rues allemandes reflète une image différente, car les minorités, en particulier les musulmans, sont confrontées à des vagues croissantes d’hostilité et de discrimination. Selon l’Agence européenne des droits fondamentaux 2024, 68 % des musulmans d’Allemagne ont déclaré avoir été victimes de discrimination raciale, soit l’un des taux les plus élevés de l’Union européenne
Il reste extrêmement difficile de déterminer l’ampleur exacte de ces incidents, car la documentation dépend principalement des organisations de la société civile (OSC). Pour combler cette lacune, un nouvel observatoire des discriminations anti-musulmanes a été créé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le premier de ce type au niveau de l’État. Des centres similaires de surveillance de la discrimination à l’encontre des LGBT, des Roms, des Sinti, des communautés africaines et asiatiques ont également commencé à fonctionner dans l’État. Cependant, le ministère responsable du projet a précisé que ces centres n’ont pas l’autorité légale pour évaluer les crimes ou imposer des sanctions, mais seulement pour documenter les incidents afin de comprendre leur prévalence.
Bien que des organisations de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch aient tiré la sonnette d’alarme sur la montée du “racisme antimusulman », le terme lui-même est controversé, car il n’existe pas de définition officielle en Allemagne. Le gouvernement allemand n’a pas investi dans des études ou des politiques visant à soutenir les personnes touchées, ce qui reflète un manque de reconnaissance officielle de ce type de discrimination en tant que phénomène intrinsèquement raciste, plutôt qu’une simple hostilité religieuse. Selon l’indice de religion 2023 de la Fondation Bertelsmann, l’islam est toujours perçu comme une menace par une grande partie de la société.
Un rapport récent d’une organisation non gouvernementale a révélé qu’en 2023, une moyenne de cinq crimes, agressions ou incidents de discrimination à l’encontre des musulmans en Allemagne ont eu lieu chaque jour. La plupart de ces incidents visaient des individus, en particulier des femmes musulmanes, mais le rapport n’incluait pas les messages de haine en ligne ou les tracts et affiches de propagande antimusulmane. Avec un total de 1 926 incidents documentés, ce chiffre n’est que la « partie émergée de l’iceberg », car un grand nombre de cas ne sont pas signalés, soit parce que les victimes ne connaissent pas l’existence des centres de signalement, soit parce qu’elles considèrent la discrimination comme normale et familière, soit parce qu’elles craignent la police en raison d’un manque de confiance dans les autorités dû à des expériences passées négatives.
Les conclusions du groupe d’experts indépendants sur le racisme antimusulman indiquent que ce phénomène n’est pas seulement un problème individuel, mais qu’il fait partie de la structure de la société allemande et de ses institutions. Tout en saluant des initiatives telles que le nouveau centre de surveillance en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les experts soulignent que « le racisme ne concerne pas seulement les individus, il fait partie de la structure institutionnelle et sociale ». Par conséquent, les centres de signalement des discriminations anti-musulmanes devraient travailler en étroite collaboration avec la société civile et les institutions académiques, ce qui a déjà commencé dans le centre de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est géré en collaboration avec deux associations régionales. Le centre devrait publier son premier rapport annuel en 2026, sur la base de recherches rigoureuses et de critères scientifiques.
Dans ce contexte, la question reste posée : Ces mesures conduiront-elles à de véritables changements dans la gestion de l’islamophobie croissante en Allemagne, ou les efforts resteront-ils limités à la surveillance et à la documentation, sans impact réel sur les politiques et la législation ?