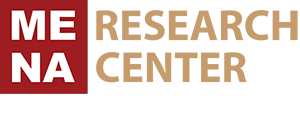Dans une décision judiciaire qui devrait faire jurisprudence, le tribunal de Paris a rendu ses jugements dans l’affaire des instigateurs et complices de l’assassinat de l’enseignant français Samuel Paty, condamnant les huit accusés, dont une femme, à des peines allant de un à seize ans d’emprisonnement. Le tribunal a souligné que leurs actions ont directement ou indirectement contribué au crime, qui a secoué la France et le monde il y a quatre ans. L’auteur de l’attaque, un réfugié tchétchène de 18 ans, a été abattu par la police après le crime.
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty a été décapité par Abdullah Anzurov, un jeune homme d’origine tchétchène, près de son école dans la ville de Conflans-Saint-Honorén, en banlieue parisienne. Anzorov a perpétré son attentat à la suite d’une vaste campagne d’incitation en ligne contre lui, après qu’il eut montré des caricatures du prophète Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression. Pour éviter d’indisposer ses étudiants musulmans, il leur a proposé de fermer les yeux ou de quitter le cours.
Mais un élève a par la suite prétendu que l’enseignant avait délibérément expulsé des élèves musulmans pour avoir insulté le Prophète, et a relayé cette information à son père, Ibrahim Chnaina, qui a lancé une campagne sur les médias sociaux qui a joué un rôle essentiel en alimentant la colère contre Patti, et a contribué à pousser Anzorov à perpétrer l’attaque meurtrière.
Le tribunal a condamné Ibrahim Chnaina à 13 ans de prison, tandis qu’Abdelhakim Safraoui, le militant islamiste franco-marocain qui a contribué à diffuser les fausses allégations contre Patti, a été condamné à 15 ans de prison, les juges ayant estimé qu’il avait lancé une « fatwa numérique » qui avait poussé l’enseignant à être pris pour cible.
Azim Ibsarkhanov et Naim Boudaoud, les amis du tueur qui l’ont aidé à se procurer l’arme du crime et l’ont transporté sur les lieux, ont été condamnés respectivement à 13 et 15 ans de prison.
Quatre autres personnes, dont une femme, qui faisaient partie de ce que l’on appelle la « djihadosphère » et communiquaient en ligne avec Anzurov avant le crime, ont été condamnées à des peines plus légères, au grand dam des victimes et de leurs représentants légaux, qui ont jugé ces peines insuffisantes au regard de l’ampleur de la tragédie.
Au début du procès, la sœur de l’enseignant décédé, Mikaelle Paty, a exprimé sa consternation quant au fait que son frère n’ait pas bénéficié de la protection nécessaire, alors qu’il avait été averti qu’il était en danger. La controverse s’est intensifiée après que certains ont blâmé Patti lui-même, l’accusant d’une « interprétation rigide de la laïcité ».
Cela ne s’est pas arrêté là ; Mikaelle Paty a porté plainte contre un chercheur doctorant à la Sorbonne, après que celui-ci a écrit sur X (anciennement Twitter) que l’incident n’aurait pas eu lieu sans « l’islamophobie qui imprègne la France », ajoutant : « Patti était vraisemblablement un islamophobe laïc »
Si certaines voix ont fait valoir que les peines prononcées étaient légères par rapport à la gravité du crime, d’autres ont averti que l’affaire jetait une ombre lourde sur la société française, en particulier à la lumière de l’escalade des menaces à l’encontre des enseignants.
Dans la ville d’Esso, à l’ouest de Paris, les enseignants d’une école se sont mis en grève après qu’une professeure d’art a été menacée par des élèves et des parents musulmans pour avoir discuté du tableau « Diane et Actéon » de l’artiste italien Giuseppe Cesare, qui représente cinq femmes nues. Cela a provoqué la colère de certains élèves, qui considéraient l’exposition de l’œuvre d’art comme une insulte à leurs croyances religieuses.
L’affaire Samuel Paty reste un tournant décisif dans le débat sur les limites de la liberté d’expression, de la laïcité et du discours religieux en France. Si certains estiment que la peine est disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction, d’autres affirment que le véritable défi réside dans la capacité de l’État à protéger ses enseignants et à faire respecter les principes de la République face à la montée des tensions religieuses et sociales.